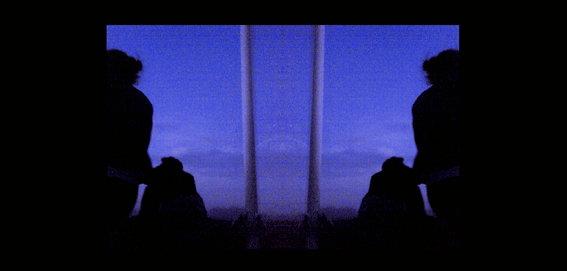Ecrit le 11.11.11 à 09h00
Il y a des jours comme ça, on sait qu’ils ont commencé d'un pied adroit. Il a suffit de descendre la rue, y voir un bout de mer et penser, on y serait décidément bien.
Alors j’ai marché.
A huit heures du matin un jour férié, la hâte dans le ventre.
Et, les gens doivent le ressentir sûrement. On m’a félicitée pour mes dents. On m’a dit que j’étais belle. Deux fois. On m’a adressé des salutations, des bonjours, de larges sourires. On m’a donné son numéro de téléphone, on s’est assis à ma table échanger quelques mots avec l’accent, on m’a offert à boire en douce lors de son service, l’espace d’une rue à descendre. L’espace d’une rue à descendre et autant d’êtres qui ont choisi de faire un pas vers moi. C’est étrange. Il y a des jours comme ça. Où l’on doit resplendir. J’ai une de ces envies d’expérimenter le silence. Je chéris ces matinées de nuits presque blanches qui me laissent avide de contemplation, sereine, à moitié endormie, l’autre davantage consciente, de l’environnement alentour, de la beauté des gestes, simples, de l’envol d’un oiseau, la course d’un nuage, du vent qui nettoie les trottoirs, des mains gantées qui sortent les poissons frais des caisses et des odeurs iodées mélangées au café des lève-tôt. Je me sens, à ma place. Anonyme. Invisible mais vivante. Spectatrice. C’est agréable de temps en temps, spectatrice.
Hier, on fêtait les vingt-cinq ans de Poubelle, je n’avais pas l’intention de sortir. Je m’y suis rendue pour elle, et j’y suis partie pour un autre. C’est lorsque l’on commence enfin à se faire à sa solitude que l’on rencontre la possibilité d’un quelqu’un auprès de qui on aimerait construire. Dommage. Je ne suis pas prête à refaire les mêmes erreurs. J’ai refroidi mon cœur pour qu’il se préserve, pour ne pas qu’il s’essouffle trop vite. Alors, je ne brûle pas de désir, et j’ai de la patience.
Il y a de ces personnes qui n’ont besoin que de vous toucher pour vous faire ressentir, et de ce type inverse, celles qui n’ont pas besoin de toucher pour vous émouvoir. De ce dernier type, le corps est subsidiaire. C’est la pensée qui prédomine, l’esprit, essentiel. L’envie de se fondre ne s’en tient qu’aux regards et même si le visuel attire de là à passer le cap du tactile il s’en est créé des mondes. Et je sais qu’on vient pas du même.
Je suis un être de chair qui a peur de salir.
Il m’a dit « qui aurait cru que tu faisais si bien l’amour ».
Sauf que moi, il m’en faut beaucoup plus pour me satisfaire.
Moi, je suis insatiable, intransigeante du doigté, de la force avec laquelle on m’enserre. Je suis vorace, chienne, féline. Et je mords. Au lit, la politesse m’ennuie, la douceur n’est pas suffisante, j’aime les gourmands qui ne mangent pas du bout des lèvres, il faut se coller, se sentir au plus profond, dans les entrailles.
Ce qui m’effraie avec les gentils, c’est la gentillesse. C’est qu’il leur en faut peu, qu’ils s’extasient facile. Ca m’inquiète, ce fossé dans le ressenti, ne pas avoir eu l’impression d’avoir évolué dans la même pièce, vécu les mêmes chocs, ensemble. Je n’ai jamais réussi à sortir avec l’un d’entre eux, soit parce qu’au dernier moment j’ai fui les deux jambes à mon cou, soit parce que je leur ai fait peur, ou qu’ils feignaient de s’intéresser à moi. Ca n’est jamais allé plus loin qu’un émoi idéaliste.
A l'exception d'hier soir.
| Joueb.com
Envie de créer un weblog ? |
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web. |
Débarrassez vous de cette publicité : participez ! :O)