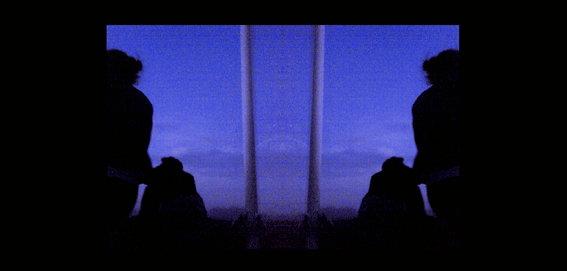Ecrit le 22.01.11 à 00h50
Quand je tourne la tête à gauche j’ai son regard qui me fixe. « Tous les mardis de décembre ». Merde. J’en ai fait trois sur quatre. Je viens de rentrer de la capitale, à nouveau. A la différence que cette fois, il n’y était pas. Je viens de rentrer de la capitale, les doutes en réponse et les remises en question. L’essentiel quelque peu bafoué. On a demandé à ma sincérité de se rhabiller parce qu’il n’y avait pas grand-chose à voir. Plate de l’intérieur? Tiens, on ne me l’avait pas encore faite celle là.
J’aurais besoin qu’on me ramasse, qu’on me rassure. Qu’on me dise que je peux continuer quand même. Qu’il y avait des choses bien aussi. Des évidences non formulées en guise d’erreur. Parce que ce je me suis pris au détour de ce comptoir entre minuit et une heure du matin c’était un coup de poignard d’une qualité inestimable, le poignard. La finition impeccable, l’ergonomie de génie. Et des coups dans le cœur à d’infinies reprises, toujours sur la même plaie, creusant le gouffre un peu plus à chaque fois. Le néant de ma vie. Le trou noir qui a ingurgité tous mes espoirs d’un avenir tracé au compas. Alors heureusement qu’il est là le Grand Fou. Qu’il y a ses chansons dans mes oreilles et sa voix qui me guérit des blessures musicales, des défauts de parcours, même si je me sens minable et que je regrette de l’avoir sollicité à ce point alors qu’il pense peut-être, qu’il pense sûrement les mêmes refrains qui entourent mes cauchemars présents, ceux qui enfoncent les clous dans mon crâne, me raboter le cerveau sous prétexte que je ne suis pas faite pour chanter, qu’aux yeux de certains je me suis trompée d’itinéraire qu’il n’est pas trop tard pour revenir en arrière peut-être? Qui sait. Qui peut bien savoir ce que je dois faire de ma vie.
Hier soir à s’abriter de la neige et se sécher les bottes il y avait ce bar de quartier et ce type louche et incohérent au possible qui voulait me lire l’avenir. « Il y a un homme auquel tu penses. Que tu voudrais à tout prix retrouver. »
« Eh bien jamais. Jamais tu ne le reverras. »
Il y a pourtant eu de belles rencontres. De véritables retrouvailles auprès de ce garçon au rire franc et au sourire colgate. Rom, mon danseur préféré. Les destinations changent et l’on se retrouve à attendre au même carrefour, un peu éberlués de nous voir debout l’un à côté de l’autre, les épaules de proximité. Que l’on s’est frôlés d’un peu trop près la première fois, par réminiscences. Mais quelle étrange sensation, celle de ne pouvoir le connaître réellement qu’à partir d’aujourd’hui. Le savoir maintenant bien plus qu’il y a ces quelques années d’échange, les correspondances existent désormais par nos mots prononcés à l’oreille, le temps de réaliser, les tasses de thé entre nos doigts. Je n’en ai plus besoin je crois. De t’écrire des poèmes.
Il y a des millions de choses qui me reviennent et dont j’aimerais m’épancher. Des instants, des dialogues, des atmosphères laissées par les anges qui passent. Des images. Emmitouflées.
Mais celles qui remontent à mes rétines sont antérieures. Des annexes qui ont hésité à s’imprimer sur la page. Titiller le hors-sujet. Ce sont les rues de la plage et les cheveux au vent, la coupe de glace dévorée en plein hiver, le bruit de la moto qui démarre et le siège qui glisse, qui glisse. Qui glisse doucement vers toi. Comme si c’était l’air ambiant qui voulait nous rapprocher, mon ami de toujours. On s’est vus mutuellement naître, sauf qu’on s’en rappelle plus vraiment. Pour le reste, on s’est peu creusés. A faire des cabanes sous les tables, des labyrinthes deux pièces, j’ai toujours été amourachée par l’enfant qui jouait avec moi. C’était un secret évidemment. Sauf qu’aujourd’hui tu manges à ma table et plus en dessous, et tu te perds lorsque tu me regardes, sans justification à émettre. Ca ne m’aurait rien fait de particulier si tu ne m’avais pas proposé de réchauffer mes mains dans ton manteau et ce siège qui glissait alors ne fut plus un obstacle, je te sentais tout contre moi, ton dos de garçon réservé fondu en ma poitrine, ce n’était pas l’attraction mais la gravité qui me collait à tes reins. La gravité horizontale des liens verticaux. Je n’avais jamais eu l’occasion de confronter nos deux corps, même d’un seul geste. Et voilà ce que ça fait.
J’y pense encore. J’y pense tous les jours. Et tous les jours je me dis que ce n’était rien, rien d’autre qu’une légère embrassade, que la pensée est obsolète et qu’il y a des milliers d’histoires inachevées à remplir avant l’éventualité de celle-ci qu’il ne faut pas s’attarder, sur les détails, sur les chemins, sur le passif, il n’y a pas de signe ni même de brèche à saisir pour s’y engouffrer, que tu ne m’attires pas, pas trop, qu’il y a pire, qu’il y a des désirs mais des devoirs aussi et que je ne peux pas t’abîmer -et que me dirait ta mère, parce que tu sembles fragile et qu’on ne peut pas jouer avec les personnes qui nous ont vu grandir.
Seulement, je brûle d’envie de remonter sur ta bécane.
| Joueb.com
Envie de créer un weblog ? |
ViaBloga
Le nec plus ultra pour créer un site web. |
Débarrassez vous de cette publicité : participez ! :O)